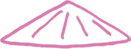Entretien avec Pierre Carles
De Juppé, forcément… à Hollande, DSK, etc.
Texte paru dans la revue Tête-à-tête, N° 3, « Images du pouvoir », printemps 2012
Pascal Benvenuti (Tête-à-tête) : Pourriez-vous nous parler du film que vous préparez actuellement ?
Pierre Carles : Il s’agit d’un remake de Juppé, forcément…, que j’ai réalisé en 1995 pour Arte [1]. Cette enquête révélait comment la presse – en l’occurrence le journal Sud-Ouest, qui est en situation de monopole à Bordeaux, et France 3 Aquitaine – fabriquait un élu. En surmédiatisant la candidature d’Alain Juppé à la mairie de Bordeaux bien avant les élections municipales, alors qu’il ne s’était pas officiellement déclaré candidat, la presse faisait sa campagne.
On peut établir un parallèle avec ce qu’il s’est passé en 2010 et 2011, lorsque Dominique Strauss-Kahn qui n’était pas officiellement candidat à la présidence de la République – il l’était en réalité, on le sait aujourd’hui, mais faisait lui aussi semblant de ne pas s’être décidé – était le chouchou des grands médias. La majorité de la presse n’arrêtait pas de souligner qu’il était le mieux à même d’occuper le poste de président de la République. Les patrons de presse ont tellement vu en lui l’homme idéal pour défendre leurs intérêts que leurs journaux n’ont pas arrêté de donner un écho important aux moindres signes de sa candidature.
C’est ce qu’il s’est passé avec Alain Juppé en 1994 à Bordeaux. À l’époque, il était ministre des affaires étrangères et numéro deux du RPR derrière Jacques Chirac. Ses moindres allées-venues à Bordeaux donnaient lieu à des reportages. Même scénario avec Strauss-Kahn. Les deux hommes n’étaient pas officiellement déclarés candidats, ne voulaient pas apparaître comme des hommes politiques ayant des ambitions politiciennes, donnaient l’impression de se sacrifier : « Vous m’appelez, vous avez envie que je me présente, que je sois candidat. Bon, d’accord, si vous insistez je serai candidat. Je vais me sacrifier, je vais faire don de ma personne ».
Il y a beaucoup de parallèles entre la manière dont la bourgeoisie bordelaise a suscité et soutenu la candidature d’Alain Juppé – sachant que le journal Sud-Ouest est très lié à la bourgeoisie bordelaise, ce sont des grandes familles de Bordeaux, les Glotin, les Lemoine qui étaient derrière tout cela – et comment, quelques années plus tard, les grands journaux on fait la campagne de Dominique Strauss-Kahn. La grande bourgeoisie française voulait de lui comme président avant que le scénario ne s’effondre lors de l’affaire du Sofitel de New York. Ce qui est intéressant, c’est que le candidat de rechange, celui que ces médias ont adopté juste après, a le même profil que Dominique Strauss-Kahn. François Hollande a lui aussi fait Sciences-po et HEC. C’est une sorte d’échange standard. Lorsqu’il y en a un qui n’est plus en état de marche, ce n’est pas grave, on prend un modèle similaire à la place.
Ce qui m’intéresse, c’est comment les grands médias présélectionnent un homme à leur convenance pour le porter au pouvoir.
TàT : Tout ceci est fait sous couvert d’une prétendue « démocratie participative » par le biais des primaires socialistes organisées en octobre 2011, où, là encore, les médias avaient déjà désigné leur vainqueur, « le seul capable de battre Nicolas Sarkozy ». Le traitement médiatique a même permis au parti socialiste de sortir grandi du « succès des primaires ».
P. C. : Peut-être que cela a été un succès, je n’en sais rien. Ce qui est sûr et certain, c’est qu’à partir du moment où Dominique Strauss-Kahn n’était plus en mesure d’être candidat, François Hollande a bénéficié de la faveur des grands médias. Il correspondait davantage à l’idée qu’ils se faisaient du candidat de « gauche » que, par exemple, Arnaud Montebourg, même si le positionnement de gauche d’Arnaud Montebourg est probablement opportuniste. En tout cas, ses positions pendant la primaire socialiste étaient moins compatibles que celles de Hollande avec les intérêts de la grande bourgeoisie française.
Ce qui m’intéresse dans cette affaire – que ce soit en 1995 avec Juppé ou en 2010, 2011, 2012 avec Strauss-Kahn et Hollande – c’est comment les grands médias présélectionnent un homme à leur convenance pour le porter au pouvoir. Pouvoir municipal dans le cas de Juppé, pouvoir présidentiel avec DSK/ Hollande. Si Hollande n’est pas élu président, ils s’accommoderont de Nicolas Sarkozy qui a toujours défendu leurs intérêts. Finalement, le choix qu’ils proposent voire imposent aux électeurs, c’est de voter Hollande-Sarkozy, ou d’imaginer à la limite Bayrou. Mais pas question d’un président de gauche. À trois mois de la présidentielle, ils verrouillent l’élection en proposant ce choix restreint.
La grande arnaque, c’est de faire passer ce duel-là pour un duel gauche-droite alors qu’en réalité c’est surtout un conflit de personnes de droite ou du centre mais pas un affrontement de programmes politiques. Le choix qui est proposé est celui d’un candidat du centre droit (Hollande) ou d’un candidat de la droite dure (Sarkozy). Or les journaux présentent ça comme un duel gauche-droite. Là, il y a vraiment une incroyable manipulation.
TàT : Vous parlez de manipulation, mais ce qui est marquant dans Juppé, forcément…, c’est cette apparente bonne foi des journalistes à bien faire leur travail sans aucun parti pris. Les journalistes ont-ils conscience de ce que vous nommez « manipulation » ?
P. C. : Les journalistes « de base » ont peu conscience de cela. Julien Brygo, qui coréalise Hollande, DSK, etc. a fait un entretien dans les locaux de Libération avec Matthieu Ecoiffier, l’un des responsables de la « surmédiatisation », – de la propagande, plutôt – pro-Strauss-Kahn puis pro-Hollande dans les pages de ce journal. Mais alors qu’Ecoiffier a écrit des articles d’une grande complaisance sur ces deux candidats, il nie en bloc. Il semble ne pas avoir du tout conscience du travail qu’il fait. Il est dans le déni total : « non, ce n’est pas vrai, on a fait notre boulot correctement, on n’a favorisé personne ».
Ce système marche d’autant mieux que les protagonistes n’ont pas conscience des manipulations qu’ils opèrent, des saloperies qu’ils commentent. Enfin, pas tous : les responsables de l’information, les rédacteurs en chef, les patrons de journaux savent bien, eux, ce qu’ils font. Mais certains journalistes politiques ne s’en rendent pas compte, ils font cela avec une certaine innocence. C’est tellement naturel pour eux de surmédiatiser les « gros candidats », d’écrire des articles sur leur personne – des articles « people » donc – qu’ils ne peuvent pas ne pas les imaginer au second tour de l’élection.
Pourquoi ne rapporterions-nous pas les moindres faits et gestes de Dominique Strauss-Kahn ou de François Hollande ? Ces sont des gens connus, c’est normal, non ? Dans ce petit milieu, on s’auto-intoxique et on finit par intoxiquer le public. C’est une auto-prophétie, c’est-à-dire qu’à force de raconter que cela ne peut se jouer qu’entre ces deux-là, finalement, les journalistes puis les électeurs finissent par se convaincre que c’est le cas, que les autres candidats n’ont aucune chance. Il n’y a qu’à voir la condescendance avec laquelle les journalistes interviewent les candidats de gauche, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, ou même Eva Joly. C’est extraordinaire ! D’emblée ils considèrent qu’ils ne sont pas aptes à devenir président de la République. En ce qui concerne Eva Joly, quand elle n’a pas voulu se mêler des accords électoraux avec le PS, quand elle n’a pas voulu avaliser l’échange de circonscriptions contre des concessions sur le nucléaire, son comportement a été taxé d’inexpérimenté par les médias. On aurait pu aussi dire qu’elle s’était montrée intègre. Non, ça a été présenté comme de l’inexpérience de sa part. Idem pour Philippe Poutou du NPA ou de Nathalie Arthaud de LO qu’on traite avec mépris ou condescendance.
Lorsqu’Eva Joly a proposé qu’il n’y ait plus de défilé militaire le 14 juillet, là aussi, les médias ont relayé complaisamment certaines déclarations des hommes politiques de droite mais aussi de gauche qui trouvaient scandaleux que l’on s’attaque à ce rituel. Il n’est venu à l’idée de personne d’aller voir ce qu’il se passait en Allemagne : les Allemands ne font pas de défilés militaires. Cela prouve qu’il n’y a rien d’incroyable à ce qu’il n’y en ait pas dans une grande puissance. On cite souvent l’Allemagne comme modèle, comme référence. Mais là, bizarrement, l’Allemagne n’intéressait plus les journalistes.
Dans une double page de Libération du 9 janvier, on peut lire : « à Jarnac, Hollande grave sa stature dans le marbre » [2]. Les journalistes le comparent à Mitterrand, ils prétendent qu’il a la même gestuelle. Je suis sûr que l’on prendrait n’importe quel autre candidat et on lui trouverait ce même type de gestes : un candidat qui pointe le ciel du doigt ou qui serre les poings. C’est n’importe quoi, c’est de la propagande pro-Hollande.
Aujourd’hui, dans le même journal, la une sur Cantona, « Je cherche 500 signatures ». J’aimerais bien voir si le jour où Philippe Poutou n’arrive pas à obtenir 500 signatures, ce qui est probable, ils écriront en une « Philippe Poutou : je cherche 500 signatures ». Là, ils s’en foutent, ils savent bien que Cantona ne fait pas campagne, mais que pour se faire entendre, il faut qu’il intervienne dans le cadre de la présidentielle.
TàT : Dans Juppé forcément…, il semble plus ou moins avoué de la part des journalistes qu’il faut des noms connus pour vendre du papier, n’est-ce pas ce qui fausse toute prétendue objectivité dans l’information ?
P. C. : Oui, il y a une logique commerciale, avec le souci de se démarquer des autres journaux. On est à ce moment-là dans la communication, dans le commerce, on n’est pas dans l’information. Même si l’information c’est aussi du commerce. Là, cette une avec Cantona, ce n’est que du commerce.
Le dîner du Siècle [3] comme symbole de la collusion entre les différentes sphères de pouvoir
TàT : Avez-vous le sentiment que la collusion du politique et du médiatique génère une certaine image du politique ?
P. C : L’une des manipulations les plus importantes est de présenter le pouvoir politique comme étant encore le principal lieu de pouvoir, alors que le périmètre de l’État s’est énormément réduit depuis les débuts de la Ve République. Dans les années 60 ou 70, un président de la République avait plus de pouvoir qu’aujourd’hui.
Dans quelle mesure un patron de multinationale n’est-il pas plus puissant qu’un ministre des transports de nos jours ? On pourrait se poser la question. En se focalisant sur le pouvoir politique comme lieu principal du pouvoir, on fait diversion. Il faudrait couvrir le pouvoir économique, comme on couvre le pouvoir politique. C’est là que ça se passe, c’est là que des gens prennent des décisions qui concernent la vie de la majorité de la population. Le pouvoir politique n’est peut-être plus qu’un simple relais du pouvoir économique. Sous le quinquennat de Sarkozy c’était flagrant… [4]
TàT : Justement, en conclusion de Fin de concession [5], votre idée était de chercher à mettre un peu plus en lumière le dîner du Siècle [6] qui, à la manière du Bilderberg, réunit presque en catimini les différentes sphères de pouvoir…
P.C. : C’est une combinaison de tous les pouvoirs : médiatiques, politiques, économiques. C’est là que ces puissants accordent leurs violons. Ils pensent à peu près tous pareil, ils ont développé à peu près la même vision du monde, mais il leur faut parfois se synchroniser, un peu comme des gens synchronisent leurs agendas électroniques.
TàT : Que tirez-vous de ces actions [7] menées durant la tenue des dîners du Siècle ?
P. C. : Cela n’a pas été très probant. Tout récemment, dans la revue Médias [8], David Pujadas a continué de dire les mêmes âneries qu’avant, comme si ça ne lui avait pas servi de leçon [9]. Il a tout de même pris conscience, grâce à nous, qu’il n’interviewait pas de la même manière un syndicaliste sur le terrain des luttes sociales et le président de la République qui le convoque au Palais de l’Élysée. C’est tellement énorme qu’il ne peut pas le nier. Mais on ne peut pas dire que ça l’ait fait douter, que ça l’ait amené à se poser un certain nombre de questions sur son travail, sur sa fonction, sur son rôle de laquais du pouvoir.
Au Siècle, les journalistes font profil bas aujourd’hui. Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de responsables de l’information qui se vantent aujourd’hui d’aller au Siècle. On leur a fait honte, ça a servi peut-être à ça mais ça n’a pas changé fondamentalement les choses. Cela ne remplace pas les luttes sociales, l’imposition de nouveaux rapports de forces. C’est le seul langage qui fait plier les puissants : un rapport de force en leur défaveur.
TàT : Ce qui a semblé compliqué dans cette action, c’est cette tentative de récupération par des groupuscules à la fois d’extrême droite, mais aussi, surtout, des adorateurs de la théorie du complot, de la « conspiration », qui imaginent le monde comme dirigé par les satanistes, les reptiliens ou les francs-maçons. Comment se positionner face à ces « amis » dont on se serait bien passé ?
P. C. : On ne peut pas interdire à des gens de venir à des manifestations. On peut se démarquer d’eux en expliquant qu’il n’y a pas besoin de complot pour que le système fonctionne.
Parfois, il peut y avoir des manipulations qui sont proches du complot, comme l’affaire des couveuses au Koweït pendant la première guerre en Irak. Il y a eu un documentaire qui montrait qu’une agence de communication avait fabriqué un faux pour tromper les médias et faire accepter à l’opinion publique la guerre en Irak. Il fallait faire passer les Irakiens pour des monstres, pour des méchants qui voulaient enlever des bébés et, ainsi, justifier la guerre.
Il peut y avoir parfois des complots, mais ils ne sont pas nécessaires. Le simple fait de partager la même vision du monde, de protéger ses intérêts et ceux de sa classe, de constituer la seule classe sociale conservant une conscience de classe (comme le disent Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot à propos de la haute bourgeoisie française [10]), tout cela suffit, pas besoin de complot.
TàT : N’est-ce pas délicat pour vous dans la mesure où certains de ces adeptes de la théorie du complot se revendiquent de votre travail, mais aussi de celui de Pierre Bourdieu ?
P. C. : À chaque fois qu’ils viennent me voir, je les déçois, parce qu’ils s’attendent à ce que je confirme leurs délires. Comme je ne vais pas dans le sens de ce qu’ils voudraient entendre, ils sont toujours un peu déroutés, déstabilisés, déçus. Mais ce n’est pas grave. On n’est pas là pour faire preuve de démagogie, pour dire aux spectateurs de nos films ce qu’ils voudraient entendre. Ce n’est pas comme cela que je conçois mon travail.
Il y a moins de divergences politiques entre Hollande et Sarkozy qu’entre Hollande et Poutou, Hollande et Arthaud et même Hollande et Mélenchon.
Forme et fond de la critique du pouvoir par l’image
TàT : Comment votre prochain film va-t-il se présenter de manière formelle ? Opérez-vous des parallèles avec les images que vous aviez pu récolter à l’époque de Juppé ?
P. C. : On essaiera de diffuser côte à côte Juppé, forcément… et Hollande, DSK, etc. En les mettant en parallèle, on verra à quel point, depuis 1995 et même avant, les choses n’ont pas changé. C’est une histoire dont on ne tire pas les leçons, qui est d’une certaine manière sans conséquences.
Cela fonctionne toujours pareil : il y a un processus de présélection des candidats par les médias qui ne laissent pas vraiment le choix aux électeurs. On cite toujours l’élection présidentielle de 1995 et la défaite du candidat des médias, Édouard Balladur, comme contre-exemple, pour nous faire croire que les électeurs ne tiendraient pas compte de l’avis des médias. C’est faux. En surmédiatisant le duel Balladur-Chirac, les médias on réduit le choix des électeurs à ces deux candidats. Balladur ou Chirac, c’était blanc bonnet ou bonnet blanc vu que les deux appartenaient au même parti politique. Il ne s’agissait pas d’un combat de programmes politiques mais d’un simple duel de personnalités.
C’est la même chose pour la présidentielle de 2012. On a commenté en permanence le match Hollande-Sarkozy en exagérant les différences de programme entre ces deux-là, pour ne pas laisser aux électeurs d’autres choix possibles. Or il y a moins de divergences politiques entre Hollande et Sarkozy qu’entre Hollande et Poutou, Hollande et Arthaud et même Hollande et Mélenchon. Élire Arthaud, Mélenchon ou même Eva Joly à la présidence de la République est présenté comme quelque chose d’impensable. Si besoin est, on fera appel à l’argument du vote utile : « électeur, attention, si vous ne votez pas pour François Hollande mais pour un autre candidat de gauche, vous risquez d’être responsable de l’arrivée au second tour de Marine Le Pen ». On se sert de Le Pen comme d’un épouvantail pour, au final, empêcher les électeurs de voter pour de vrais candidats de gauche.
TàT : En apparence, votre travail semble accorder davantage d’importance au fond qu’à la forme. Quelle est votre intention artistique pour ce nouveau film ? Comment le situez-vous esthétiquement ?
P. C. : Au départ, le projet de revenir sur la même histoire à dix-sept ans d’intervalle a été inspiré par un film de Jean Eustache : La Rosière de Pessac [11]. Je suis originaire de Bordeaux et j’ai filmé en 1988 la cérémonie de la Rosière de Pessac, soit dix-neuf ans après Eustache, à la manière de ce dernier. C’est une cérémonie où une jeune femme est élue pour représenter la ville. Elle est censée être vierge, présenter des garanties de respectabilité, d’honorabilité, etc. Eustache avait filmé la cérémonie en 1968 puis en 1979. Onze ans plus tard, pas grand-chose avait changé, le rituel se poursuivait, immuable. En fait, c’est la répétition d’un rituel avec quelques petites variations que l’on observait. Avec Juppé, forcément… et DSK, Hollande, etc. c’est à peu près la même chose. Finalement, le temps s’écoule mais pas tant que ça, les choses ne changent pas vraiment. Il y a beaucoup plus d’invariants que de bouleversements.
Après, d’un point de vue formel, mon documentaire est très classique. Il prend la forme d’une d’enquête composée à la fois d’archives, d’une analyse de ces archives par des critiques des médias et de séquences d’interpellation de journalistes responsables de l’information et, par conséquent, de ces manipulations médiatiques. Il y a trois registres d’images dans DSK, Hollande, etc., comme dans Juppé, forcément…
TàT : Vous dites « classique », mais, en même temps, la forme de vos films est relativement différente du « journalisme d’investigation » que l’on trouve habituellement dans les grands médias.
P. C. : Non, je ne crois pas que cela soit très différent. Quand on regarde Juppé, forcément… c’est quelque chose d’assez classique. La preuve : c’est passé sur Arte.
TàT : Oui et c’est vrai que ce n’est pas le seul de vos films à avoir été diffusés à la télévision.
P. C. : Il y a eu les courts que j’ai réalisés pour Strip-Tease [12]. Ils sont passés à la télévision dans les années 90. En revanche, mes longs métrages, réalisés seuls ou avec d’autres réalisateurs indépendants, n’ont jamais été diffusés sur les chaînes hertziennes, sur le câble ou le satellite. Le seul qui a été diffusé, c’est Choron dernière [13] sur la chaîne câblée Planète.
Je comptais proposer à la télévision de produire DSK, Hollande etc., mais personne n’en a voulu. La télévision n’a peut-être pas envie de raconter à quel point elle fabrique un simulacre de démocratie.
Le débat télévisé comme simulacre de démocratie
TàT : Dans un article paru dans le Monde Diplomatique de janvier [14], dont une double page est consacrée à Bourdieu, le sociologue est cité pour parler du rejet des journalistes à accepter leur objectivation : « J’ai eu la joie d’être attaqué, souvent assez violemment, par tous les journalistes français, parce que ces gens qui se croient des sujets n’ont pas supporté de découvrir qu’ils étaient des marionnettes ». Pourquoi ces producteurs d’images du pouvoir refusent-ils toute objectivation de leurs pratiques ?
P. C. : On retrouve cette méfiance dans tous les milieux. Dans le milieu des réalisateurs auquel j’appartiens, on n’apprécierait pas forcément un film qui, nous objectivant, montrerait que l’on est moins libre que ce que l’on affirme. Lorsqu’on est pris pour objet, on ne réagit pas toujours bien. La différence, c’est que dans le milieu des journalistes on a la possibilité de dénigrer publiquement ceux qui vous objectivent. C’est ce qu’a fait, par exemple, Daniel Schneidermann avec Pierre Bourdieu. Son émission de télévision a été objectivée par Bourdieu [15] qui a mis à jour son dispositif de plateau inégalitaire en montrant à quel point il donnait une prime au point de vue dominant, à ceux qui portaient des idées reçues, et défavorisait ceux qui tentaient d’exposer des idées non-reçues, des points de vue non-orthodoxes, hérétiques. Schneidermann n’a pas supporté que Bourdieu critique ce dispositif qui apparaissait comme démocratique. Là encore, on est dans cette histoire de simulacre de démocratie.
Effectivement, si l’on donne le même temps de parole aux uns et aux autres, à deux opposants par exemple, on pourrait penser que c’est démocratique du fait de cette apparente équité. En réalité non. J’ai abordé cette question dans un film intitulé Enfin pris ? [16]
TàT : Vous preniez d’ailleurs référence sur Serge Halimi [17] et Noam Chomsky [18] qui avaient expliqué l’inégalité dans le débat d’idées dans les médias lorsque des personnes cherchent à exprimer des points de vue non-orthodoxes, qui n’ont pas été matraqués pendant des dizaines de milliers d’heures à la télévision. Même avec un temps de parole égal dans un débat télévisé, les idées s’opposant à la pensée dominante ont un nombre incalculable d’heures de démonstration de retard, ce qui les met en position d’infériorité avant même le début du débat.
P. C. : Là encore, on est dans le registre du simulacre de démocratie.
Des outils sociologiques pour une critique des médias
TàT : Vous parliez d’objectivation du travail des journalistes dans Juppé, forcément… Votre dernier film en date, Fin de concession, n’est-il pas une tentative d’objectivation de votre propre travail, du moins une tentative de réflexivité sur votre pratique cinématographique ?
P. C. : Oui, c’est important de se poser un certain nombre de questions sur nos limites, sur nos faiblesses. C’est ce que j’ai tenté de faire dans Fin de concession, ce que l’on a fait avec les gens avec qui je travaille, les monteurs, la productrice Annie Gonzalez. Ce regard réflexif n’a pas forcément plu aux spectateurs. Je pense qu’il faut le faire, c’est important, mais il ne faut pas que ce soient de fausses autocritiques. Pas mal de gens concèdent le minimum pour ne pas avoir à concéder l’essentiel : on fait mine de se reprocher quelque chose pour ne pas avoir à se reprocher des choses plus graves. Dans les médias, il y a pas mal de gens qui sont coutumiers de ce genre de fausses autocritiques.
TàT : L’exemple le plus flagrant étant certainement celui des émissions sur la télévision à la télévision qui ne critiquent finalement pas grand-chose, elles participent justement à une sorte d’auto-célébration du travail des uns et des autres. Comment en êtes-vous venu, dans votre parcours, à passer de la sociologie à la critique par l’image ?
P. C. : J’ai fait de vagues études de sociologie que je n’ai jamais terminées. Et ce n’est pas parce que j’ai fait un film sur Pierre Bourdieu, La Sociologie est un sport de combat [19], que je suis pour autant sociologue ou spécialiste en sciences humaines. J’ai intégré une école de journalisme faute d’avoir réussi le concours d’une école de cinéma, la Femis. Je n’avais pas de vocation particulière à devenir journaliste. En étant dans cette école, à Bordeaux, j’ai pu observer beaucoup de choses. J’avais déjà les outils pour porter un regard critique sur le fonctionnement de cette école et la conception de l’information qui y était enseignée. Ces observations m’ont permis de développer un regard critique quand je me suis ensuite retrouvé à la télévision, et de ne pas adhérer à ce qui était demandé tacitement à la plupart des journalistes, c’est-à-dire faire de la communication plutôt que de l’information, être du côté du pouvoir ou du divertissement plutôt que d’exercer un contre-pouvoir. Mais je n’avais pas de prédispositions particulières à cela.
TàT :Au début des années 90, quand vous avez travaillé à la télévision, vous vous êtes rapidement retrouvé en marge de la production télévisuelle en développant une critique des médias dans des émissions qui a priori ne s’y prêtaient pas forcément. Est-ce que votre hiérarchie avait connaissance de vos intentions ?
P. C. : À l’époque, il n’y avait pas vraiment d’émission de critique des médias, donc cela ne pouvait être mené que par des francs-tireurs qui essayaient de faire ce travail seuls dans leur coin, en infiltrant des émissions qui n’étaient pas à l’origine destinées à cela. C’était de la contrebande et je n’avançais pas à visage découvert, je ne disais pas que j’allais faire un boulot de critique des médias à l’intérieur de ces émissions. Ça n’a pas duré longtemps. À partir de 1994, j’étais déjà grillé dans la plupart des émissions de télévision susceptibles de diffuser ce travail. Je suis resté cinq ou six ans à la télévision, pas plus.
La production indépendante des images du pouvoir
TàT : Après la télévision, comment est-ce que vous décidez de procéder ?
P. C. : Je n’ai pas vraiment décidé, c’est l’occasion qui a fait le larron. Un de mes sujets qui avait été censuré par Canal +, Pas vu à la télé, est devenu un long métrage, Pas vu pas pris [20]. Ce long métrage est sorti en salles et a eu un certain succès. Il nous a permis de monter une société de production pour produire mes films, de même que d’autres films.
L’an dernier, Squat, de Christophe Coello est sorti en salles, produit par Annie Gonzalez et C-P Productions. Cet outil de production est très indépendant, mais nous ne sommes jamais totalement indépendants. Nous sommes dépendants par exemple du public des salles de cinéma. Si les spectateurs ne viennent pas voir nos films, on a du mal à faire d’autres films. Nous sommes indépendants de la télévision et relativement indépendants des institutions, même si parfois il y a des financements institutionnels, notamment des régions ou du Centre National du Cinéma. Mais ce n’est pas fondamental. Nous avons créé cet outil de production avec une quinzaine de personnes, techniciens, collaborateurs, etc. qui avaient pratiquement tous travaillé sur Pas vu pas pris. Par contre, le nouveau film sur lequel je travaille actuellement se fait en autoproduction. C’est un moyen métrage, donc il est impossible de le sortir en salle. Je le fais avec Julien Brygo, un jeune journaliste très talentueux qui collabore au Monde Diplomatique et Aurore Van Opstal, une jeune journaliste belge très culottée.
TàT : Ce film ne va donc sortir que sur support DVD ?
P. C. : Oui, mais on va surtout le diffuser sur internet à partir du 15 avril si tout se passe bien. On va demander aux internautes et aux spectateurs qui l’auront vu sur internet, de le financer après coup, soit en achetant le DVD, soit en faisant un don.
Ce film n’aurait pas pu voir le jour si, les uns et les autres, nous n’avions pas mis notre travail en participation. La télévision n’avait aucune envie de le produire, le cinéma ne pouvait pas, donc, si ça vous intéresse, si vous voulez voir d’autres documentaires de ce type, il faudra les financer d’une manière ou d’une autre. C’est la première fois que nous allons mettre un de nos films en libre diffusion sur internet. À terme, l’ensemble de mon travail y sera visible. C’est quelque chose qui est en construction.
TàT : En quoi la mise à disposition gratuite vous intéresse-t-elle ?
P. C. : Le principe m’intéresse à condition qu’il génère des ressources pour fabriquer des films. Il ne faut pas croire qu’on peut faire les choses gratuitement, elles ont un prix. Pour l’instant, Sony ne donne pas de caméras, les bancs de montage ne sont pas gratuits, travailler à la réalisation de films est un travail à plein temps qui demande un certain nombre de moyens. On ne peut pas faire ça bénévolement à moins de risquer de faire des films de mauvaise qualité. Le principe du bénévolat peut marcher une fois, mais il n’est pas viable à long terme.
Mes derniers films n’ont pas marché suffisamment pour générer des recettes ou en tout cas déclencher des financements automatiques de la part du CNC qui permettraient de démarrer d’autres films de manière autonome. Avec C-P Productions, nous sommes dans une situation délicate du fait de l’insuccès des deux derniers films produits par la société, Fin de concession et Squat. Le modèle économique que l’on avait constitué à l’époque de Pas vu pas pris arrive peut-être à son terme.
TàT : Est-ce qu’un film comme celui-ci a un budget comparable à celui d’un film « classique » ?
P. C. : C’est du travail, du montage, du tournage, du repérage, de la documentation, mais non, ce n’est pas comparable. Si on voulait le faire correctement, il nous faudrait au moins 70 000 euros. Ça nous permettrait de payer tout le monde. Là, on va le faire à l’arrache, chacun amène ce qu’il peut. Ce genre de films pas vraiment désirés par le système n’a pas d’autre possibilité d’être produit autrement qu’en autoproduction.
TàT : Ce fonctionnement vous convient-il ou est-ce un choix par défaut ?
P. C. : Non, ça ne me convient pas. Quand on est en situation fragile, économiquement parlant, on peut difficilement se consacrer à un film. Ce n’est pas une situation idéale.
TàT : Vous avez suivi la logique inverse, puisque vous vous êtes complétement grillé à la télévision et vous retrouvez dans une situation de plus en plus incertaine…
P. C. : Oui, c’est le prix à payer.
Propos recueillis par Pascal Benvenuti
[1] Pierre Carles, Juppé, forcément… (31’, 1995).
[2] Laure Breton, « À Jarnac, Hollande grave sa stature dans le marbre », Libération, 9 janvier 2012.
[3] Le Siècle est un club privé réunissant les élites des différentes sphères de pouvoir (politique, économique et journalistique). Ses membres se réunissent une fois par mois pour un dîner à l’automobile club de France, situé sur la place de Concorde à Paris.
[4] Cf. Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Le Président des riches : enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, Paris, Zones, 2010.
[5] Pierre Carles, Fin de concession (128’, 2010).
[6] François Denors, Paul Lagneau-Ymonet et Sylvain Thine, « Aux dîners du Siècle, l’élite du pouvoir se restaure », Le Monde Diplomatique, février 2011.
[7] De septembre 2010 à janvier 2011, Michel Fiszbin et Pierre Carles ont organisé des rassemblements sauvages lors de la tenue des dîners du Siècle afin de protester contre la présence de journalistes dans ce club.
[8] Emmanuelle Duverger et Robert Ménard, « David Pujadas : Notre problème ? Le panurgisme… », Médias, n° 31, hiver 2011.
[9] Le 30 juin 2010, David Pujadas s’est vu remettre « la laisse d’or du journaliste le plus servile » par le journal Le Plan B. On retrouve cette « cérémonie » dans le film Fin de concession.
[10] Voir Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Les ghettos du gotha : comment la bourgeoisie défend ses espaces, Payot, Paris, 2009, mais aussi Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, « Sur la piste des nantis », Le Monde Diplomatique, septembre 2001.
[11] Jean Eustache, La Rosière de Pessac (60’/67’, 1968 et 1979).
[12] Pierre Carles a réalisé une dizaine de documentaires pour l’émission belge « Strip-Tease » dont Pas de calmants pour Jeanne (1996) et Le désarroi esthétique (1996).
[13] Pierre Carles et Eric Martin, Choron dernière (104’, 2009).
[14] Pierre Rimbert, « À cent contre un », Le Monde Diplomatique, Janvier 2012.
[15] Pierre Bourdieu, « Analyse d’un passage à l’antenne », Le Monde Diplomatique, avril 1996.
[16] Pierre Carles, Enfin pris ? (93’, 2002).
[17] En référence au livre de Paul Nizan, Les chiens de garde, Rieder, Paris, 1932, voir le livre de Serge Halimi, Les Nouveaux chiens de garde, Liber-Raisons d’agir, Paris, 2005. Gilles Balbastre et Yannick Kergoat en ont réalisé une adaptation en film, sortie dans les salles en janvier 2012.
[18] Noam Chomsky et Edward Herman, La Fabrication du consentement. De la propagande médiatique en démocratie, Agone, 2008.
[19] Pierre Carles, La sociologie est un sport de combat (146’, 2001).
[20] Pierre Carles, Pas vu pas pris (90’, 1998).
Pascal Benvenuti est né en 1980. Doctorant en sociologie au CERLIS sous la direction d’Alain Quemin, il est spécialisé en sociologie de l’art et sociologie de la culture. Musicien, il s’occupe également d’une petite maison de disques indépendante, Et mon cul c’est du tofu ?