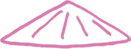Interview de Pierre Carles
Ils ont vu jaune
Télérama, « Sortir », 13-11-2019
Version intégrale de l’interview de Pierre Carles, par Jérémie Couston (Télérama), réalisée en octobre 2019
Jérémie Couston (Télérama) : Depuis les frères Lumière, l’époque semble toujours ne se laisser filmer que dans la rue, pourquoi ?
Pierre Carles : La limite des représentations audiovisuelles des conduites humaines, c’est de ne s’en tenir qu’à ce qui est visible et relativement spectaculaire. Et de négliger ce qui travaille souterrainement, de se focaliser sur la face immergée de l’iceberg plutôt que sur les processus qui conduisent les individus à agir comme ceci ou comme cela et pas autrement, notamment « dans la rue » ou sur la scène publique. Idéalement, il faudrait réussir à filmer la tectonique des plaques et pas seulement les manifestations visibles des chocs sociaux, soit les « tremblements de terre » issus de la poussée de ces plaques tectoniques. Mais qui sait filmer la tectonique des plaques sans ennuyer le spectateur ? Pas moi. C’est pourtant là que les choses se jouent, que tout se met progressivement en place pour déboucher sur des éruptions sociales.
J. C. : Comment ne pas trahir ce(ux) qu’on filme ? Est-ce une question essentielle à vos yeux ?
P. C. : D’une certaine manière, on trahit toujours ceux que l’on filme. Ne serait-ce que parce qu’on en sait forcément plus sur eux qu’ils n’en savent sur nos intentions, ou même sur ce que nous savons d’eux. L’acte de réaliser un film instaure une relation déséquilibrée. La question serait plutôt : comment éviter les abus de pouvoir de la part des filmeurs ? Sachant que les conséquences des abus de pouvoir ne sont pas les mêmes pour quelqu’un qui dispose des moyens de se défendre, ou qui sait se défendre, que pour un individu ou un groupe qui serait relativement démuni. Un abus de pouvoir commis à l’égard d’un agent social disposant d’un certain pouvoir - économique, culturel, symbolique - n’a pas les mêmes conséquences qu’à l’égard d’une personne en situation de faiblesse. C’est à cela qu’il faut faire attention. Et pour répondre à la deuxième partie de la question : oui, c’est une question essentielle à mes yeux.
J. C. : Est-il nécessaire de partager la colère de ceux qu’on filme ?
P. C. : Pas forcément. De la même manière qu’il ne faut pas obligatoirement être sociologue pour faire un film sur… Pierre Bourdieu (me semble-t-il). Mais il vaut mieux ne pas être trop éloigné – spatialement, culturellement, socialement – de ceux que l’on veut représenter à l’image si l’on souhaite être en mesure de comprendre ce qui se déroule sous l’œil de la caméra. En ce qui concerne notre film sur les gilets jaunes du rond-point d’Aimargues (Gard), ne nous racontons pas d’histoires : nous ne partagions pas leur colère, nous n’étions pas dans une situation économique qui nous aurait conduits par nécessité à bloquer les ronds-points à l’annonce de la hausse du prix du gazole. Mais le fait d’être des réalisateurs provinciaux, vivant en dehors d’une grande agglomération (ce qui est le cas de la majorité des membres de l’équipe du film), d’avoir été confronté un jour ou l’autre à des relations de domination de la part de Paris (ou des élites des grandes métropoles, ce qui revient au même ou presque), d’être très dépendants de la voiture pour notre vie quotidienne, tout cela fait que nous nous sommes retrouvés à avoir une certaine empathie avec le mouvement des gilets jaunes. Car cette révolte raconte aussi un conflit Paris-province. Ainsi qu’un conflit culturel et social. Contrairement à bonne partie de la petite bourgeoisie culturelle, notamment dans l’univers des professions du spectacle, nous n’avons pas jugé avec mépris les gilets jaunes les premiers jours du mouvement comme l’amuseur Guillaume Meurice sur France Inter ou d’autres de ses collègues. Je me souviens que lors des toutes premières occupations des ronds-points, le week-end du 17 et 18 novembre, certains de nos amis intermittents du spectacle affichaient une certaine défiance voire une franche hostilité à l’égard des gilets jaunes perçus comme trop proches du Front National, ou comme des gros « beaufs » aux comportements misogynes, ou comme insensibles aux préoccupations environnementales, bref, anti-écolos, etc. Dans les milieux de cette petite bourgeoisie culturelle s’affichant de gauche, celle à laquelle nous appartenons qu’on le veuille ou pas, le mouvement des gilets jaunes n’a pas forcément soulevé l’enthousiasme au tout début, c’est le moins qu’on puisse dire. Aussi, il fallait casser certains préjugés, lutter contre certaines idées reçues pour s’intéresser à cette rébellion inattendue. Mais nous n’avons pas un grand mérite : c’est le simple fait d’habiter au même endroit que les gilets jaunes, de les avoir pour voisins ou pour amis qui nous a « sauvé ». C’est probablement ce qui nous a permis de ne pas porter un regard négatif ou condescendant sur ce mouvement à ces débuts.
DOC/FICTION
J. C. : La vérité passe-t-elle forcément par le documentaire ?
P. C. : De mon point de vue – mais cela n’engage que moi – ce sont surtout des romans qui racontent le mieux l’époque. Soit des œuvres de fiction mais qui peuvent parfois être extrêmement documentées.
J. C. : Réaliser une fiction sur le même sujet était-il envisageable ?
P. C. : La question ne s’est jamais posée. Notre film fabriqué pour l’essentiel à partir des images des téléphones portables des gilets jaunes constitue seulement une tentative de documenter la vie d’un rond-point – d’un lieu de mobilisation « ordinaire », disons – les premières semaines du mouvement des gilets jaunes. On peut aussi le voir comme un document à caractère ethnographique.
MISE EN SCÈNE
J. C. : Aviez-vous un principe de mise en scène avant de tourner ?
P. C. : Nous n’avons tourné aucune séquence, à l’exception d’un plan aérien à la toute fin de l’occupation du rond-point d’Aimargues, afin de restituer le paysage après la bataille. Rien n’a donc été mis en scène, au sens où on l’entend habituellement.
J. C. : Quelles différences entre vos images et celles de la télévision ?
P. C. : Si notre film avait été produit par la télévision, il y aurait probablement une voix off « informative » de type journalistique et un montage très serré, le tout accompagné d’une musique omniprésente à caractère illustratif. Objectif : prendre le spectateur par la main pour qu’il sache immédiatement ce qu’il faut comprendre. Ne pas lui laisser une seconde de travail, d’activité. Or dans notre film, ce dernier doit se débrouiller avec les images et sons qui lui sont proposés. Le montage est certes une forme de commentaire ou de « voix off » non-déclarée mais il essaie d’éviter de forcer la main au spectateur. C’est du moins ce que l’on espère.
J. C. : Les Facebook live et autres vidéo en direct ont révolutionné le témoignage in situ et les relations entre police et manifestants, chacun se sachant potentiellement filmé en permanence. Quel est le rôle d’un cinéaste face à la multiplication des images ?
P. C. : Nous avons utilisé certains « Facebook live » comme sources de documentation de la vie des gilets jaunes du rond-point d’Aimargues. Pour bien faire, il aurait fallu réaliser tout un travail sur les messages écrits qui apparaissaient sur les écrans des téléphones portables des filmeurs/émetteurs mais nous n’avons pas eu les moyens ni le temps de le faire. C’est dommage car cela racontait aussi l’époque.
MESSAGE
J. C. : Quel discours vouliez-vous relayer ? Quel message vouliez-vous faire passer ? A-t-il changé au cours du tournage ?
P. C. : Pour les historiens des temps futurs, ce film permettra peut-être de comprendre ce qui se passait sur les ronds-points pendant le mouvement des gilets jaunes. Dans une zone de France qui est un fief du Front National (ce dernier a fait près de 50 % des voix aux dernières élections européennes), on s’apercevra qu’on ne scandait pas de slogans racistes ni de propos tenant les immigrés pour responsables des problèmes sociaux en France. C’est l’axe riche/pauvre qui a structuré la révolte : Macron « le président des riches », faisant de cadeaux fiscaux à ces derniers versus des salariés précaires ou travailleurs n’arrivant pas joindre les deux bouts car trop taxés. Voilà l’opposition qui structurait les revendications des insurgés, pas l’axe immigrés/nationaux. Nous ne sommes pas autocensurés à ce propos. On a beau être dans un bastion de l’extrême-droite, les manifestants n’ont pas pour autant adopté la vision du monde du FN durant le mouvement. S’il y a peut-être un message caché que l’on voulait faire passer, c’est celui-là. Mais le premier objectif était de documenter l’ingéniosité de l’auto-organisation dont ont fait preuve les gilets jaunes.
J. C. : Tous les films sur les récentes luttes populaires (Nuit debout, solidarité avec les migrants, GJ…) sont des films d’empathie. Pourquoi n’existe-t-il aucun film, aucun cinéaste pour prendre le contre-pied ?
P. C. : Est-ce intéressant de faire des films stigmatisant les minorités ou les dominés ? Les films d’empathie avec les dominants, c’est plutôt le boulot habituel de la télévision, non ?
J. C. : Le cinéma militant est-il condamné à être de gauche ?
P. C. : Plutôt que de gauche ou de droite, il me semble que les films sont plus ou moins « autoritaires » ou plus ou moins « libertaires ». Certains films dits de « gauche » sont en réalité de droite car très autoritaires. Bien qu’animés d’idéaux dits de gauche, ils veulent nous forcer à penser d’une certaine manière, à nous émouvoir pour telle ou telle cause « progressiste » mais en marchant au pas. Ce sont des films militants mais au sens militaire du terme. Et ça, non merci…
J. C. : Avant vous, quel cinéaste, quel film a, selon vous, filmé son époque avec le plus d’acuité ?
P. C. : Luc Moullet ? Pierre Merejkowsky ? Jean-Pierre Mocky ? Frederick Wiseman ?
J. C. : Un an après, quel bilan tirez-vous du mouvement des GJ ?
P. C. : Globalement positif.