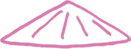Autour de « Bages-Sigean à la rame » et « Gruissan à la voile »
Entretien avec Pierre carles et Philippe Lespinasse
Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce film ? Quelle est la genèse de ce projet ?
Pierre Carles : On avait commencé cette série de films de voyage il y a une douzaine d’années. L’idée était de faire le tour des côtes françaises à pied, en rencontrant les gens de manière impromptue, et en essayant de filmer ce qui reste de vie « à l’ancienne », d’activités traditionnelles le long du littoral. Sachant que souvent, ce sont des endroits où pas mal de gens se débrouillent, pêche, la chasse, le braconnage, auto-construisent… On se disait que ça pouvait être intéressant de faire le tour complet du littoral français sous forme de journal de bord vidéo, pour livrer un état des lieux de ces modes de vie en voie de disparition. On a fait deux brouillons, ce que l’on appelle aussi dans le métier des « numéro zéro », entre la frontière belge et Dunkerque puis entre la frontière italienne et Menton. Philippe Lespinasse qui avait ses entrées à France 3 Aquitaine s’est ensuite vu commander le premier « vrai » reportage qui était le tour du bassin d’Arcachon à pied. Sur ce tournage, j’étais seulement cadreur et non co-réalisateur. Même chose pour le second reportage, le tour de l’estuaire de la Gironde à mobylette. Il y a trois ans Tiziana Cramerotti de France 3 Toulouse nous a commandé « Bages Sigean à la rame », une sorte de canoë-movie, que j’ai coréalisé cette fois-ci. Une fois monté et diffusé, on avait des frustrations. On se disait qu’on n’avait pas fini notre périple dans ce coin-là. Avec le producteur Youssef Charifi, on a donc proposé « Gruissan à la voile » qui se déroule dans le même secteur : entre Narbonne et Port la Nouvelle. On est donc reparti pour un tour avec un nouveau moyen de transport, même si finalement dans « Gruissan à la voile », il n’y a pas beaucoup de voile...

Philippe Lespinasse : La genèse, le départ, c’est toujours partir à la découverte d’un lieu, si possible en dehors des sentiers battus, mais jamais exotique, touristique, ou spectaculaire. En tous les cas, notre exotisme à nous se nourrit de ces coins en friches, entre-deux, mélangeant sur un même territoire des économies de fin du monde, du système D, et des tentations de développement touristique. Les étangs sont d’une infinie beauté, très variés sur un petit espace, et en même temps en dehors des autoroutes obligées du tourisme. Ça nous amuse toujours, cette idée de la grande aventure, vue par le petit côté de la lorgnette. Tous les personnages que nous rencontrons ont une dimension épique, et sont comme les acteurs d’un péplum, un péplum à petit budget. Ils sont de là, incarnant de manière très naturelle un rapport à la nature que nous avons perdu. Le cinéma c’est toujours ça, retourner voir les gens, ou des choses qu’on a perdus.
Le principe du déplacement à pied, en mobylette ou en canoé n’est pas une facétie. Dormir dehors quand on le peut, manger frugal, ou vite fait, partager notre chambre, même dans les petits hôtels, c’est juste être dans une économie qui se rapproche de celle des gens qu’on filme. Car on peut voir comme une obscénité incroyable la confrontation de l’économie des journalistes –avions, voitures de location, matériel onéreux, salaires…-avec celle des gens que nous sommes censés raconter. On s’est dit depuis longtemps que si les journalistes ou les réalisateurs éprouvaient les mêmes conditions que leurs interlocuteurs, ils seraient un peu moins arrogants, plus proches, plus disponibles en tous les cas. Je déteste pour ma part cette expression « prendre de la hauteur », c’est bien un point de vue supérieur, ça. Le point de vue des mecs qui font de l’hélico, en faisant semblant de regretter la misère du monde. Bon, et en plus, avec nos systèmes de locomotion, nous attirons la sympathie, il ne faut pas se le cacher, et ça fabrique aussi une cohérence dramatique, car nous intégrons les avatars de notre voyage au film. Nous nous sommes fait voler les mobylettes dans un film précédent, nous l’intégrons. Dans « Bages Sigean », nous trouvons sur une plage un œuf d’autruche, qui nous sert plus tard de monnaie d’échange. Nous ne pouvions tomber sur cet œuf que parce que nous étions en canoé. Dans celui-ci, c’est l’histoire du bateau à voiles qui fait le lien, le suspense.

Pourquoi ces lieux du littoral ?
P. C. : Avec Philippe qui est un vieux copain, on aime depuis longtemps se balader dans ces endroits intermédiaires, qui ne sont pas spécialement touristiques ni totalement sauvages, mais où subsiste des pratiques de glanage, de bricolage, de démerde, des petits métiers… Peut-être qu’on s’y reconnaît nous aussi. Moi en tout cas, je me considère comme un bidouilleur dans mon métier de cadreur-monteur-réalisateur. Et puis on est très sensibles à ces activités artisanales, à ces métiers qui sont en train de disparaître : marins-pêcheurs d’étang, maraîchers en polyculture, charpentier de marine, sauniers des marais salants … On est très attentif à ces métiers-là avant qu’il ne disparaissent définitivement.
P. L. : J’ai écrit un petit texte là-dessus, sur les étangs qui seraient à l’origine du monde, et en même temps le lieu de son agonie. Bon, c’est un peu emphatique vu comme ça, mais les étangs sont une sorte de petite matrice autour de laquelle sont venus s’agréger plein de petites activités en lien direct avec le biotope. Des ramasseurs de toutes sortes, des agriculteurs sensibles, des apiculteurs érudits, des chasseurs émotifs…des filles et des garçons qui brouillent un peu les clichés. En tous les cas rien que l’on ne trouve dans un catalogue, ou dans un magazine touristique sur la région. On dit en anglais de quelqu’un décalé qu’il est « border line », « border », c’est en même temps le bord et la frontière. C’est ça les gens des étangs, ils sont au bord, au bord de quelque chose qu’on poursuit. Une vibration particulière. Pierre et moi nous n’avons fait que des films sur les bords, des films littoraux.
Il y a donc une petite teinte de tristesse ?
P. C. : Oui mais en même temps, sauver les traces de ce qui subsiste encore, c’est peut-être aussi affirmer : ça a existé donc il n’y a pas de raison que ça ne ré-existe pas. On ne dramatise la disparition de ces activités-là. Notre regard n’est pas larmoyant. Juste un peu nostalgique et bienveillant.
P. L. : Ce qui disparaît n’est pas moins triste que ce qui apparaît, les lotissements, les grandes surfaces de périphérie, les zones commerçantes imaginées par les plus maboules des urbanistes et qu’on laisse faire. Petit à petit l’abandon de la relation à la nature, aux animaux, aux savoirs faires, et la délégation de tous ces savoirs à des spécialistes, des intermédiaires.
Y a t-il chez vous une attirance pour cette vie rustique ?
P. C. : Je pense que la parenté est dans la démarche artisanale elle-même : nous sommes des artisans de la vidéo et du documentaire, en tout cas moi je revendique le terme. Philippe aussi, même s’il est plus proche de l’industrie car il travaille, de son côté, pour la télévision nationale. Mais on aspire idéalement à exercer notre métier de manière artisanale, c’est à dire à fabriquer les films à notre rythme, avec des collaborateurs que l’on a choisit, comme la monteuse Marie-Hèlène Mora. C’est peut-être ça qui nous rapproche de ceux que nous filmons : le besoin de se lancer dans des entreprises utiles ou du moins non-nuisible. Et si possible de manière relativement autonome et artisanale, des choses dont on pourrait être fiers à l’arrivé. On se sent donc relativement proche mais aussi éloigné des gens que l’on filme parce que nous sommes des urbains tandis qu’eux sont surtout des ruraux... Mais peut-être y a t-il en nous cette illusion que l’on pourrait redevenir un jour chasseur, cueilleur, pêcheur, « bouscaïlleur »... Mais derrière tout cela, il y a surtout l’idée de choisir son mode d’existence, plutôt que de le subir une vie non-choisie. Ça rejoint la volonté auquel on aspire beaucoup de se réaliser à travers un ouvrage : quand tu fais un film de manière artisanale, tu as vraiment le sentiment d’avoir fait un objet unique, un prototype, quelque chose qui n’a pas d’équivalent, et peu importe qu’il soit raté ou réussi : il est singulier. Malheureusement, c’est de plus en plus difficile dans nos sociétés de pouvoir fonctionner ainsi. Comme les Compagnons du tour de France, je veux parler le tour de France des artisans... La tendance aujourd’hui c’est plutôt de fabriquer des choses en série, interchangeables, standardisées, reproductibles à l’infini. Bon, je m’égare…
P. L. : Je suis attiré par ces gens comme je suis attiré par des artistes, ou des intellectuels. Ils savent, ils disent, ils incarnent une matière à penser, ou à rêver. Pierre peut faire un film sur le sociologue Pierre Bourdieu, pour le cinéma, et s’approcher avec autant d’empathie d’un apiculteur ou d’un pêcheur d’anguilles. Il ne s’agit pas de comparer leurs œuvres, mais l’émotion de ces rencontres a autant de valeur. Et nous ne nous prenons pas pour les gens que nous filmons, notre boulot consiste à faire passer, à transmettre, à faire comprendre. Parfois on bascule un peu, on met la main à la pâte, on participe aux activités. Mais Pierre veille à ne pas tomber dans la démagogie, c’est mon garde chiourme.

Es-tu satisfait de ce dernier film « Gruissan à la voile » ?
P. C. : Même si c’est un film produit par France 3, même si je ne suis pas sur mes terrains habituels – la critique des médias, la critique du salariat, le portrait au long cours – j’assume complètement ce film. En tant que réalisateur, ça m’amuse beaucoup d’ intégrer dans le film la question des rapports avec un copain de tournage, de montrer l’envers du décor, de désacraliser un peu le mythe des grands reporters : Là, nous sommes en quelque sorte des reporters amateurs qui faisons de manière néanmoins professionnelle un grand petit reportage ou petit grand reportage...
Je pense que le deuxième opus, « Gruissan à la voile », va plus loin que le premier, du point de vue de l’originalité de la réalisation. Le premier a un montage plus télévisuel, alors que celui-ci est plus audacieux.
Concernant le duo Pierre-Philippe : il y a d’un coté un Pierre plutôt analytique, tatillon, voir cynique, et de l’autre un Philippe plus joueur, optimiste voir utopiste. Le film tient-il sa force et son pari à travers ce tandem ?
P. C. : Ces traits de caractère existent vraiment. Simplement, j’accentue un peu le coté rabat-joie, emmerdeur, chieur, pendant ce tournage. Et Philippe n’a pas à trop se forcer pour apparaître plus positif, plus « professionnel », plus prêt à faire le travail qu’on nous a commandé. Moi c’est plus le détournement de la commande qui m’intéresse. Philippe est plus légaliste. C’est normal, il travaille encore pour la télévision. C’est son gagne-pain, ce qui n’est pas mon cas. Donc on joue sur ce contraste pour former un duo, on s’amuse de cela. Dans « Bages-Sigean » on discutait du fait de filmer ou pas des paysages. Dans « Gruissan à la voile » je m’interroge sur la réussite de notre entreprise, si l’on fait bien ou pas le travail que France 3 attend de nous… Ou encore : sommes nous des imposteurs ? Je ne pense pas que le film tranche là-dessus. Il laisse le spectateur libre de penser ce qu’il veut. Un autre de nos objectifs : montrer l’envers du décor, dévoiler les coulisses du tournage. Notre film, c’est un peu « splendeur et misère d’une équipe de pieds nickelés travaillant pour France 3 régions ».
P. L. : Pierre est une sorte de samouraï des temps modernes, capable d’inventer des dispositifs et de les explorer jusque dans des recoins inimaginables. Il ne renonce jamais, défend mordicus une idée, même si elle est complètement saugrenue. Il peut se mettre en danger pour une idée, un projet, ou une démarche. Quelque soit l’enjeu, on a toujours l’impression qu’il n’a rien à perdre, c’est ce qui fait sa force, et ce qui lui a permis de bâtir son oeuvre audiovisuelle, sans jamais céder à une quelconque pression. Il a adapté à la nature et à ses habitants sa manière de tourner très instinctive, racée, presque dure, qu’il a développée au contact des puissants. Du point de vue technique, il ne loupe rien. Il est extrèmement attentif sous ses airs désinvoltes, et très endurant physiquement. Moi,je suis plutôt un longeur, un contourneur, un poseur de collets. Je peux changer d’idée, m’adapter à la situation, suivre le vent ou revenir sur ce que j’ai décidé. Je suis beaucoup moins théoricien que lui, plus jouisseur, et en même temps plus calculateur vis-à-vis du produit final, moins libre sur les champs cinématographiques.
Pourquoi cette volonté de relater le réel, en montrant le dispositif du tournage ?
P. C. : Il y a la volonté de désacraliser ce type de reportage, et de ne pas cacher que parfois nous ne sommes pas toujours d’accord. Maintenant, est-ce que ça présente toujours un intérêt ? Je ne sais pas…
P. L. : C’est curieux comme il est toujours plus intéressant d’écouter un journaliste raconter les conditions de son reportage -les aléas, les avatars, les embrouilles ou les joies- que de regarder son travail fini, en général très lisse, très stéréotypé. On s’est dit qu’il fallait essayer d’intégrer à l’histoire principale des histoires secondaires. Et parfois l’histoire secondaire prend le dessus. Ce dosage est délicat, et même entre nous, la question n’est pas réglée.
Vous faites finalement de l’éducation à l’image ? C’est une forme de conversation implicite et omniprésente avec le spectateur pour lui donner des ficelles en lui montrant la mise en scène ?
P. C. : Oui. La difficulté est de faire en sorte que nos discussions le concernent lui aussi. Il y a effectivement ce coté : « ne vous faites pas avoir, on filme les gens mais tout ça c’est de la télévision. Les gens que vous voyez sont en représentation, devant une caméra. Ils tiennent le discours qu’on est censé attendre d’eux ». Le naturel à la télévision, c’est du cinéma. On essaie de désacraliser tout cela et de laisser aux téléspectateurs la possibilité d’être moins dupes, tout en l’associant à nos doutes, à nos discussions, à nos non-certitudes.. C’est ça le pari : mélanger ces deux niveaux de récit.
P. L. : On se montre, pas très beaux, plus très jeunes, bafouillant nos questions, mais il s’agit d’une cohérence narrative. On est pas dans le docu ampoulé et emphatique. Ailleurs, je raconte les histoires différemment, je mets du commentaire, de la musique et ça marche aussi. Pour les musées, je fais des portraits où je suis totalement en retrait. Que des entretiens, pas de commentaire, et le moins de subjectivité possible. Tout cela dépend du projet, de ce que l’on décidé en amont. Et pour montrer les coulisses, il faut aussi être capable de mettre en scène le spectacle, sinon c’est stérile.

C’est un pari plutôt réussi ?
P. C. : Le boulot qu’on nous a commandé, on l’a fait correctement : on est allé trouver ces gens dont les activités sont en fin de course, on a filmé ces « derniers des Mohicans » qui seront peut-être les premiers des survivants dans pas longtemps. Il y a, comme dans le patinage artistique, des figures imposées, comme faire un double-salto – ici filmer ce que l’on est en droit d’attendre de la télévision quand elle fait correctement son boulot – et puis des figures libres, comme nos discussions à moitié improvisées ou les accidents de tournage. Ce film-là mélange les figures libres et les figures imposées alors qu’habituellement il n’y a que les figures imposées dans les reportages télévisés.
P. L. : Je ne suis pas complètement d’accord, la télé, tout ça, c’est la vieille rengaine de Pierre. Il parle toujours d’une télé méchante, stéréotypée, comme si nous étions en danger, comme si elle allait nous contaminer. Une sorte d’Armageddon. Moi, quand on me dit que la télé consomme, s’installe, séduit, pirate et ne donne plus jamais de nouvelles, je vois bien de quoi on parle, mais je ne me sens pas concerné. A vrai dire, je m’en fous. En tous les cas le producteur et le diffuseur nous ont plutôt encouragé. Et je ne vois pas en quoi passer du temps avec les gens est une figure imposée. J’aime bien traîner, regarder le temps passer et participer aussi aux moments creux avec les personnages que nous rencontrons. On dort, on mange avec eux ou chez eux, on participe, on file un coup de main, les devoirs des enfants, les courses et la vaisselle, je fais cela sans calcul, je m’en fous. La télé ne me dicte pas cette figure « imposée ». J’ai passé douze ans à filmer la même personne, justement pour la télé. Pierre va dire que je me cache derrière mon petit doigt. Sans doute, mais je ne suis ni responsable, ni comptable des comportements hautains, mafieux ou fainéants de tous les journalistes de la télé. Et Pierre, il est toujours en train de régler des comptes, d’ailleurs, c’est toujours lui qui veut partir, changer d’endroit, il se lasse vite. Disons qu’il a quelques idées fixes, il est pour l’instant deuxième ou troisième dan, s’il abandonne quelques aigreurs, il peut encore progresser dans la voie du zen…
J’explore un paysage, ou des gens, mais lui explore le cinéma, on essaie de trouver des terrains d’entente.

Comment tu parlerais de Philippe ?
P. C. : Philippe évolue plus dans le registre des figures imposées, moi plus dans celui des figures libres. Mais il faut des deux pour que l’ensemble fonctionne. Philippe, c’est quelqu’un qui arrive dans n’importe quel endroit du monde et s’y sent tout de suite à l’aise. Il arrive à établir le contact avec les gens les plus éloignés de nous. Il est très fort pour se faire accepter aussi bien par des mareyeurs un peu marginaux de Port la Nouvelle que par des pêcheurs au fin fond de la Sibérie… Il y a un certain sans-gêne chez lui qui se révèle être une qualité. Prenons par exemple, la séquence la chasse au canard dans « Gruissan à la voile » : moi je ne voulais pas que l’on reste dormir sur place car les deux pêcheurs-chasseurs que l’on filmait n’avaient prévu qu’un seul gabion, ce petit abri flottant que l’on voit dans le documentaire, pour passer la nuit. Ils auraient dû aller en chercher un deuxième avant la tombée de la nuit au lieu de simplement nous ramener à terre et basta. Quand ils nous ont proposé de rester dormir sur l’ilôt où ils chassaient, j’étais un peu mal à l’aise. J’avais l’impression d’abuser de la situation. Ils étaient déjà bien gentils de nous garder à manger avec eux le soir , il ne fallait pas trop leur en demander. Philippe, lui, était partant pou rester et les a laissé faire. Et il a eu raison car c’est comme cela que l’on a tourné cette séquence de « désillusion » au petit matin. Donc, heureusement que Philippe s’est montré un peu sans gène sur ce coup. Il ne se contente pas d’observer. On le voit dans « Gruissan à la voile », il met souvent la main à la pâte, ce n’est pas le journaliste ou le réalisateur qui observe les gens comme un entomologiste, en surplomb. Il vit le quotidien des personnes qu’il filme, Philippe : il va à la pêche, il fait à manger, et les gens sont ravis de passer un moment avec lui.
Moi j’aurais plus tendance à me poser des questions du type : est-ce qu’on ne les dérange pas ? est-ce qu’on n’est pas de trop cette fois-ci ? Philippe lui se pose moins de questions. Et il a peut-être finalement raison parce que notre comportement habituel rend notre présence agréable et sympathique. Ça, c’est une des grandes qualités de Philippe : savoir s’incruster mais de manière sympathique. Finalement il y a tout un tas de séquences qui existent parce que Philippe s’est dit, par exemple « tiens on va acheter deux poissons au mec qui revient de la pêche et on va se les préparer ». Moi je n’aurais peut-être pas eu l’idée de faire ça.
Mais il y a aussi cette différence entre nous : lui connaît bien l’univers de la pêche, le littoral, car il travaille souvent pour l’émission « Thalassa », alors que je suis plutôt profane en la matière. D’où ce contraste entre le crédule qui pose des questions parce qu’il connaît mal le milieu qu’il filme, et l’expert qui a déjà beaucoup bourlingué dans l’univers en question. Je suis relativement naïf et je n’ai pas besoin de forcer mon caractère. J’apprends souvent des choses sur le tournage. Des trucs qu’on oublie sitôt fini le tournage. Parce qu’il ne faut pas exagérer : jamais on ne pourrait adopter le mode d’existence des gens filmés dans « Bages-Sigean à la rame » ou « Gruissan à la voile » ! A notre âge, ce n’est plus possible. Peut-être, qu’en définitive, nous ne sommes pas viables ».

Comment tu parlerais de Pierre ?
P. L. : Pierre n’a jamais récusé sa part d’enfance, et part volontiers dans n’importe quelle aventure un peu facétieuse, qu’elle soit professionnelle ou non. Lui comme moi aimons la littérature ou le cinéma biscornus, les personnages équivoques, les histoires bizarres ou les séries Z. Nous avons une admiration non feinte pour les savoirs-faire populaires, et la précision truculente des langues enracinées. Toute cette série de documentaires repose là-dessus. Sur le dispositif un peu décalé, sur l’envers du décor, et l’hommage aux hommes et aux gestes.
Sur le terrain, il est plus farouche, plus en retrait avec les personnages, presque mélancolique parfois. Il se demande pourquoi il est là, il répète qu’il n’a pas mérité ça, et a toujours peur qu’une quelconque puissance venue d’un au-delà démoniaque ne vienne le démasquer. Cette position m’amuse, car il profite quand même et par mon interrmédiaire des délices de la rencontre. Je le vois bien. Il m’envoie au contact. Je crois aussi que ça lui fait du bien, ça le change de ses tournages en milieu hostile, chez les grands patrons, au Medef, ou avec les journalistes en vue du PAF. Là il est moins sur la défensive, moins en danger. Personne ne le connaît, ni ne lui veut du mal. Il a parfois du mal à y croire.
Donc c’est plutôt lui qui filme, et moi qui engage des discussions, ou propose d’aller voir untel ou untel, de rester sur place un peu plus longtemps. J’ai cette chance de ne jamais me lasser, et d’être facilement surpris, émerveillé. Dans notre kolkhoze audiovisuel, chacun est autonome, et libre de ses mouvements. Ainsi, j’ai parfois un échange intéressant avec un personnage, mais Pierre ne le filme pas. Il est ailleurs, et a décidé de filmer autre chose. En son âme et conscience, il trouve que le moment n’est pas juste, pas authentique, surfait. Il a souvent raison. Il y a chez lui la quête d’un graal, du moment qui ne se reproduira jamais. Il a bâti tout son argumentaire là-dessus, et ne tourne rien qui ne convienne à ce critère. C’est un peu gonflant parfois, parce qu’il vaudrait mieux qu’il se laisse un peu aller, en s’abandonnant à la beauté d’un moment, d’une scène, d’une rencontre, ou d’un paysage, mais non, il ne reviendra pas là-dessus.
Il n’y a pas de hiérarchie dans cette aventure, à la différence des reportages que je tourne avec d’autres. C’est le jeu. Tout peut se discuter en permanence. On échange, on se fâche, mais on trouve toujours une solution. C’est souvent la sienne, d’ailleurs. On a aussi essayé d’intégrer ces échanges poussifs dans les films. Celui-là et le précédent. Je ne voulais pas que nos questionnements prennent le dessus sur les rencontres, sur les histoires que nous étions censés narrer, je ne sais pas si nous y avons réussi mais nous sommes allés au bout de quelque chose.
Pour le montage c’est pareil. Par un jeu d’allers et retours, nous avons alternativement monté le film, en compagnie de Marie Hélène Mora. Mais là l’expérience de Pierre avec des monteurs de cinéma lui a donné une exigence incroyable, une pertinence qui aboutit à ce film assez raide, sans concession au lyrisme facile, à l’utilisation souvent frauduleuse de la musique, ou aux effets de style. Il est le seul avec lequel je peux envisager ce type d’aventure.
Entretien réalisé par Maïna Waezi en février 2009.